Au 6 octobre 2025, le débat sur l’inflation n’oppose plus flambée des prix et chute brutale : il se joue désormais sur quelques dixièmes de point autour de la cible des banques centrales. Dans la zone euro, l’estimation flash d’Eurostat pour septembre montre une inflation qui remonte légèrement à 2,2 % après 2,0 % en août, un niveau cohérent avec l’idée d’une désinflation “atterrie” mais encore sensible aux à-coups des services et de l’énergie. Du côté américain, la Réserve fédérale a mis à jour en septembre ses projections d’inflation PCE : elle anticipe un retour graduel vers 2 % à l’horizon 2026–2027, signe que l’effort monétaire commence à porter, mais que les pressions sous-jacentes ne sont pas totalement éteintes. En toile de fond, les organismes internationaux comme l’OCDE et le FMI décrivent un monde où l’inflation globale recule, tout en restant plus hétérogène qu’avant la pandémie. Ces éléments de cadrage servent de point de départ pour éclairer deux horizons que nos lecteurs attendent : où se situe l’inflation en cette fin d’année 2025, et à quoi s’attendre en 2026 si l’on raisonne concrètement en termes de pouvoir d’achat, de coût du capital et de valorisation des actifs.
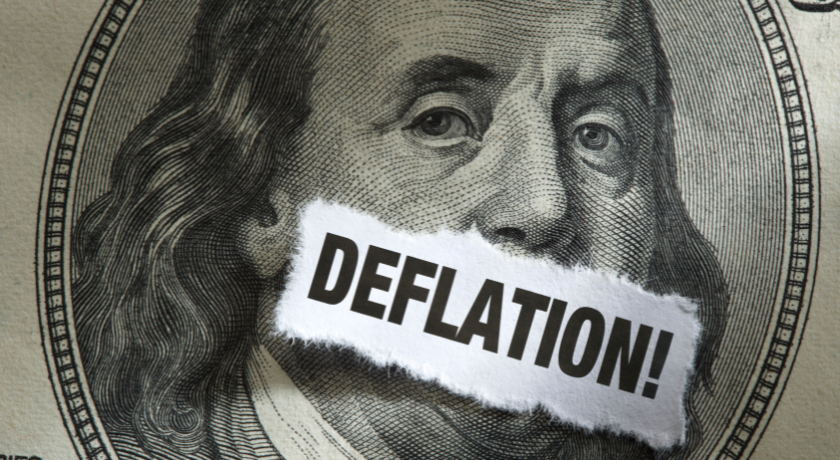
Fin 2025 : une inflation “autour de 2 %” en zone euro, un reflux graduel aux États-Unis
En Europe, la photographie la plus fraîche tient en un chiffre : 2,2 % d’inflation annuelle pour la zone euro en septembre, portée par des services toujours au-dessus de 3 % et une énergie qui cesse de tirer franchement vers le bas. Ce niveau, supérieur de justesse à la cible de 2 %, n’est pas un accident isolé mais s’inscrit dans la dynamique décrite par la Banque centrale européenne lors de ses projections de septembre : l’inflation totale doit osciller autour de 2 % jusqu’à la fin de 2025, avant de refluer davantage l’année suivante. Cela correspond à une économie où les hausses de salaires se normalisent progressivement, où l’euro un peu plus ferme modère les prix des biens importés, et où les effets de second tour liés à l’énergie s’estompent sans disparaître complètement. Ce diagnostic est important pour les ménages comme pour les entreprises : l’environnement de prix n’est plus celui de l’urgence 2022–2023, mais il reste assez ferme pour que les banques centrales évitent de relancer trop vite l’économie par des baisses de taux agressives.
Aux États-Unis, le tableau est proche mais pas identique. La Fed publie chaque trimestre un jeu de projections qui fait référence. Dans celui du 17 septembre 2025, la banque anticipe pour l’inflation PCE un profil “en pente douce” : une médiane à 2,6 % en 2025, ramenée à 2,1 % en 2026 puis à 2,0 % en 2027 ; pour l’inflation sous-jacente (core PCE), la trajectoire est la même, 2,6 % en 2025 puis 2,1 % en 2026. Ce schéma confirme que la partie la plus volatile du cycle inflationniste est derrière nous, mais aussi que la dernière ligne droite vers 2 % est la plus délicate : elle dépend de la détente sur les salaires, de l’apaisement des loyers “imputés” dans les indices américains et de l’issue des tensions commerciales qui, si elles montaient d’un cran, pourraient retarder la normalisation. La Fed accompagne cette projection d’éventails de confiance assez larges, preuve que l’incertitude reste réelle sur la cadence précise de retour à la cible.
Au niveau global, l’OCDE résume bien la situation : en 2025, l’inflation des pays du G20 continue de refluer, et l’on s’approche des cibles là où les anticipations restent ancrées et les marchés du travail se détendent. La photographie de mi-année du FMI allait dans le même sens, en notant toutefois que l’inflation américaine risquait de rester un peu au-dessus de la cible plus longtemps que dans d’autres économies avancées. Ensemble, ces vues expliquent pourquoi, en cette fin 2025, les marchés n’anticipent plus des vagues de baisses de taux rapides en Europe comme aux États-Unis mais plutôt une pause prudente, conditionnée par chaque nouvelle statistique d’inflation.

2026 : vers 1,7 % en zone euro et 2,1 % aux États-Unis, un atterrissage qui reste dépendant des salaires, des services et du commerce
La question clé pour 2026 n’est pas de savoir si l’inflation “tombe” : elle doit le faire encore un peu, et les projections centrales l’affirment clairement. Elle est de savoir si ce reflux se fait de manière homogène et soutenable, c’est-à-dire sans que les services et les loyers raniment régulièrement la flamme. En zone euro, la BCE prévoit une inflation moyenne à 1,7 % en 2026, avec un cœur d’inflation qui descend progressivement à mesure que les hausses salariales se normalisent et que la productivité se répare après le choc post-pandémie. Cette projection suppose que les effets de la hausse des coûts passés, désormais digérés par les entreprises, ne se renouvellent pas via un nouveau choc d’énergie ou de change ; elle suppose aussi que la demande reste assez modérée pour éviter les hausses de prix opportunistes là où la concurrence est moins vive. Si ces hypothèses tiennent, 2026 pourrait marquer la première année depuis longtemps où la cible de 2 % n’est pas seulement frôlée mais durablement “en vue”, au point d’autoriser des politiques monétaires moins restrictives sans perdre la crédibilité anti-inflation.
Aux États-Unis, les projections de la Fed positionnent 2026 comme l’année du “presque 2 %”, avec une médiane de 2,1 % pour l’inflation PCE totale et pour la core PCE. Derrière ce chiffre se cache un enjeu de composition : la décélération attendue tient beaucoup au ralentissement des loyers imputés et des services à forte intensité de main-d’œuvre. Si les gains de productivité promis par les investissements récents dans l’automatisation et l’IA se matérialisent, ils absorberont plus facilement des salaires encore dynamiques sans nourrir une boucle prix-salaires. À l’inverse, si des mesures commerciales restrictives s’accumulent ou si les chaînes logistiques reviennent sous tension, la “dernière marche” vers 2 % pourrait prendre quelques trimestres de plus. L’OCDE, pour sa part, voit l’inflation globale G20 passer de 3,4 % en 2025 à 2,9 % en 2026, un mouvement compatible avec l’idée d’un monde normalisant mais pas uniformément, où chaque zone économique vit sa propre inertie.
Pour les ménages, ces trajectoires ont trois implications concrètes. La première concerne le pouvoir d’achat : une inflation qui glisse de 2,2 % vers 1,7 % en zone euro en 2026, toutes choses égales par ailleurs, redonne un peu d’oxygène aux salaires réels si les hausses négociées restent proches de 3 % ou plus. La deuxième touche le coût du crédit : si les banques centrales valident la normalisation, les taux courts peuvent se stabiliser à des niveaux moins contraignants, ce qui finit par se transmettre aux prêts immobiliers et aux crédits d’entreprise avec un décalage ; la désinflation “crédible” vaut souvent plus pour les taux que la simple publication d’un bon chiffre mensuel. La troisième est psychologique : quand l’inflation devient prévisible, les décisions d’investissement redeviennent calculables, et l’on évite les à-coups de consommation défensive qui font tant de mal aux marges des entreprises et au moral des ménages.
Pour les entreprises et les investisseurs, 2026 ressemble à un terrain où la sélection redevient centrale. Les secteurs à forte intensité salariale mais à faible productivité apparente auront le plus de mal à faire passer des hausses de prix si la demande reste prudente. À l’inverse, les acteurs capables d’extraire des gains d’efficacité, de verrouiller leurs coûts d’approvisionnement et d’améliorer leur mix produits bénéficieront d’une désinflation qui réduit la prime de risque exigée par les marchés. Côté portefeuille, une inflation qui se rapproche durablement de 2 % n’implique pas d’abandonner les actifs réels, mais elle redonne tout leur intérêt aux durations plus longues si l’on croit à la crédibilité du scénario central. Les banques centrales ne promettent pas une ligne droite : elles insistent au contraire sur des intervalles de confiance larges et la possibilité de surprises symétriques. Mais leur “biais” est lisible : si les anticipations restent ancrées et si le cœur des prix se détend, 2026 est l’année où la politique monétaire pourra respirer sans risquer de rallumer la mèche.
Fin 2025, l’inflation a cessé d’être une crise ; elle est redevenue un paramètre à surveiller de près. La zone euro évolue autour de 2 % et vise 1,7 % en 2026, les États-Unis glissent vers 2,1 % la même année, et l’ensemble des grandes économies valident une normalisation à condition que les salaires, les loyers et les services suivent. Pour l’épargnant comme pour l’entrepreneur, ce scénario appelle moins un pari qu’une méthode : indexer ses décisions sur des trajectoires plausibles plutôt que sur des “pics” mensuels, calibrer ses budgets et ses prix avec des hypothèses d’inflation réalistes, et rester agile face aux risques encore présents sur le commerce mondial et l’énergie. Si 2022 a appris la prudence, 2026 pourrait réapprendre la visibilité — à condition de ne pas la confondre avec la certitude.


